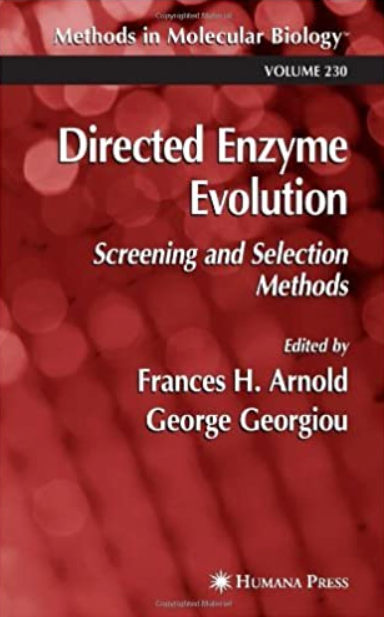Directed Enzyme Evolution: Screening and Selection Methods - Molecular Biology¹, F.H.ARNOLD.
Au cours des trois dernières années, l'approche combinatoire vers l'ingénierie des protéines a pris de l'ampleur et du succès, définissant ainsi une nouvelle discipline de recherche qui est généralement appelée évolution dirigée des protéines. Comme toute autre nouvelle discipline scientifique, les premiers stades de développement ont été accompagnés de doutes quant à sa portée et son applicabilité générale. (Sauf que, dans la nature, cette stratégie fonctionne depuis environ 4 milliards d'années avec des résultats vraiment étonnants.) Au cours de cette ère "attentiste", l'évolution dirigée a été poursuivie par un nombre relativement restreint de groupes spécialisés dans ce domaine et dans le développement de nouvelles méthodologies telles que le phage display ou le DNA shuffling. Ces méthodologies sont maintenant appliquées par de nombreux groupes, pour lesquels l'évolution dirigée n'est qu'un outil puissant et non l'essence de la recherche. L'évolution de cette discipline se manifeste dans le nombre sans cesse croissant d'articles de revues, ainsi que dans la publication des trois nouveaux ouvrages recensés ici.
Les premières applications systématiques de l'évolution dirigée au niveau des protéines remontent à la fin des années 1970, lorsque les premiers exemples de protéines évoluant en laboratoire suite à une pression de sélection artificielle sont apparus (remarquables mais souvent oubliées sont les expériences de Hall montrant comment de nouveaux variants de la β-galactosidase évolué dans Escherichia coli). L'évolution dirigée en laboratoire a connu une explosion avec le développement de l'évolution in vitro des acides nucléiques (SELEX), qui a depuis conduit à de nombreux aptamères, ribozymes et enzymes d'ADN. Le domaine de l'évolution dirigée des protéines a évolué plus progressivement, la raison principale étant que le principe simple derrière l'évolution de l'acide nucléique, à savoir que la même molécule comprend le gène et l'enzyme, ou le gène et l'entité de liaison (aptamères) ne ne s'applique pas aux protéines. Ici, lier le génotype au phénotype nécessite une cellule vivante ou des stratégies in vitro plutôt complexes. L'évolution dirigée des protéines nécessite également une gamme beaucoup plus diversifiée de méthodologies pour créer la diversité génétique et pour sélectionner cette diversité pour la fonction souhaitée.
Ces méthodologies font l'objet des deux premiers volumes décrits ici. Les volumes font partie de la série bien établie Methods in Molecular Biology de Humana Press (éditée par John M. Walker), et couvrent respectivement les méthodes de création de bibliothèques et les méthodes de criblage et de sélection. Les éditeurs de ces deux livres ont suivi le format utile de la série qui fournit de nombreux protocoles détaillés (y compris des notes traitant des parties délicates du protocole) accompagnés de courtes introductions et de quelques chapitres qui suivent un style de révision plutôt que de protocole.
Il semble cependant y avoir une différence significative dans la généralité, la portée et l'utilité des deux volumes - une différence qui est mieux décrite par la version cynique du "dogme central de la biologie moléculaire" - L'ADN donne l'ARN donne des Troubles. La fabrication de bibliothèques de gènes est un domaine clairement défini où le même protocole est applicable à presque tous les gènes. En revanche, les méthodes de criblage et de sélection (ainsi que l'expression des protéines à cribler) doivent être spécifiquement adaptées à chaque protéine et fonction. D'où les excuses inévitables des éditeurs dans la préface du deuxième volume envers les lecteurs qui ne trouveront pas d'écran pour leur enzyme préférée. En effet, le premier volume offre une couverture complète des différentes approches pour créer la diversité génétique. La plupart des méthodologies utiles sont in vitro et reposent principalement sur la PCR (amplification en chaîne par polymérase). Néanmoins, les méthodes in vivo (par exemple, l'utilisation de souches bactériennes mutatrices) sont très bien couvertes. Le volume contient également une section très utile sur « l'analyse de la diversité des bibliothèques ». À mon avis, la seule méthode généralement utile qui n'est malheureusement pas couverte est l'utilisation de la PCR à base oscillante pour la mutagenèse aléatoire. La couverture étendue, l'applicabilité générale et la clarté des protocoles font du premier volume un incontournable pour tous les groupes intéressés par le domaine, ainsi que pour les bibliothèques institutionnelles. Le deuxième volume couvre une large gamme d'enzymes, de cribles et de sélections. En ce qui concerne ce dernier, il y a un accent clair et délibéré sur les méthodes in vivo, y compris les sélections génétiques. Ce volume n'offre aucune couverture des méthodes purement in vitro (qui peuvent justifier un volume indépendant) et seulement une couverture partielle et sporadique des méthodes semi in vitro telles que le phage display. En résumé, le deuxième volume peut certainement être d'une grande utilité, principalement pour ceux qui entrent dans le domaine et souhaitent étudier diverses approches et méthodologies, bien qu'il n'y ait que quelques cas dans lesquels les protocoles détaillés qui y sont proposés peuvent être appliqués "tels quels". .”
Le troisième livre, Directed Molecular Evolution of Proteins, ne se concentre pas sur la méthodologie. Il fournit plutôt 14 chapitres qui décrivent divers aspects du domaine dans un style de révision. Bien qu'il y ait un certain degré de chevauchement dans la couverture entre ce livre et les deux précédents , ils sont globalement complémentaires. Il faut dire que, comme c'est le cas pour la plupart des livres édités, il existe une variabilité considérable dans la portée, les objectifs et la couverture des différents chapitres. Seuls quelques chapitres fournissent un large aperçu qui ne se concentre pas sur le travail des auteurs. Celles-ci constituent, à mon avis et de l'avis de plusieurs autres personnes qui ont vu ce livre, la partie la plus utile du livre. Une telle perspective telle que fournie par Lutz et Benkovic (ingénierie de l'évolution des protéines) sur les stratégies appliquées par la nature pour faire évoluer de nouvelles protéines est indispensable, car elle n'a pas d'équivalent dans un article ou un manuel. De style similaire, le chapitre de Schuster sur les aspects théoriques et informatiques de l'évolution moléculaire et le dernier chapitre sur la génération d'enzymes avec de nouvelles spécificités de substrat par Bornscheuer. Ces chapitres (et le chapitre « l'évolution de l'ingénierie des protéines » en particulier) peuvent servir de matériel de manuel et de lecture de cours avancés. Les chapitres restants se concentrent sur le travail d'un seul laboratoire ou même d'une seule enzyme. Ceux-ci sont utiles principalement pour ceux qui s'intéressent à un système particulier, et leur contenu chevauche largement les articles de revues publiés. L'accent est mis sur les enzymes et le criblage ou les sélections qui utilisent des cellules vivantes (in vivo). La couverture de ces sujets spécifiques est inévitablement partielle et parfois sporadique, avec des répétitions considérables entre les chapitres (par exemple, pour décrire la création d'une bibliothèque). Certains domaines « classiques » sont couverts (par exemple, l'évolution vers la stabilité dans les solvants organiques) alors que d'autres (par exemple, l'évolution vers la thermostabilité) ne le sont pas. Malgré ces inconvénients, ce livre est recommandé, ne serait-ce que pour les quelques grands chapitres de style manuel qui couvrent l'absence de livres à jour dans le domaine de l'évolution des protéines.